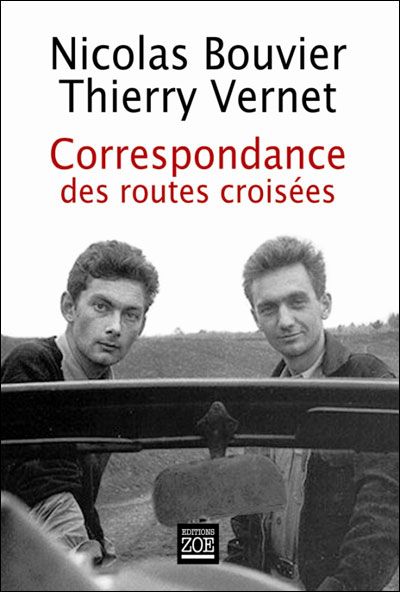La Correspondance des
routes croisées, celles de l'écrivain genevois Nicolas Bouvier
(1929-1998) et du peintre Thierry Vernet (1927-1993), vient de sortir
aux éditions Zoé. De 1945 à 1964, les centaines de lettres
échangées révèlent une amitié hors-normes et la petite cuisine
de l'Usage du monde,
magnifique livre à la gestation douloureuse qui retrace leur voyage
commun entre la Suisse et l'Afghanistan (1953-54). La publication de
cette « montagne » épistolaire est l'occasion d'évoquer
la vie et l'œuvre
de Nicolas Bouvier avec son épouse Eliane.
Quel a été votre
rôle dans la publication de ce livre ?
Dans un premier temps, je
n'avais pas très envie que cette correspondance soit publiée et mes
fils non plus car c'était trop près de la mort de mon mari (1998).
Je me demandais qui cela intéresserait. Marlyse Pietri des éditions
Zoe était convaincue que cela aurait du succès. Alors j'ai dit :
« Patience ». C'est vrai, je l'ai faite patienter à peu
près dix ans. Quand j'ai su que le Centre
de recherches sur les lettres romandes
que dirige Daniel Maggetti voulait s'attaquer à
cette montagne, j'ai donné mon accord.
Cet ouvrage est très
impressionnant, est-ce que vous avez conservé toutes les lettres ?
C'est tout à fait
particulier car chacun gardait les lettres de l'autre, depuis
toujours. Les universitaires, quand ils travaillent sur une
correspondance, ils ne veulent rien enlever. Je leur ai dit que je
leur donne le feu vert mais que je veux avoir un droit de regard par
rapport à certaines lettres. Je ne connaissais pas du tout la
correspondance du début. J'ai rencontré Nicolas en 1957 et les
échanges épistolaires commencent en 1945. Je ne voulais pas que
certaines personnes soient blessées car ils sont un peu crus avec
les gens, mais avec humour ! Je n'ai pas enlevé de lettres, j'ai
enlevé des passages où je trouvais que c'était trop intime et je
n'aimais pas que ces choses soient lues par tout le monde. Mais dans
l'ensemble, très peu. La preuve : 1600 pages !
Est-ce que vous avez
beaucoup correspondu avec lui par lettres?
Énormément.
Cela fera l'objet d'un
prochain ouvrage?
Jamais
de la vie, je peux vous dire que personne n'aura cette correspondance
! Il n'y avait pas de portables à l'époque, on a passé deux ans au
japon (1964-65) durant lesquels on a téléphoné une fois en Europe
quand mon deuxième fils est né à Tokyo. Après, Nicolas repartait
très souvent, alors on s'écrivait et il me faisait d'immenses
lettres, j'ai des dossiers mais je ne les donnerai pas à la
bibliothèque !
Quand on commence la
lecture, ils ont respectivement 16 et 18 ans et ce qui frappe c'est
leur immense culture, notamment classique.
C'est incroyable ! Cela
est dû énormément à la famille, de part et d'autre. Le père de
Nicolas était germaniste, il était directeur de la bibliothèque
publique et universitaire. Donc Nicolas était plongé dans la
littérature depuis le début. Son père recevait Thomas Mann [prix
Nobel de littérature 1929, ndlr.], il a rencontré beaucoup
d'écrivains de cette époque. Il écoutait, il s'en est imprégné.
Et puis il a développé une curiosité énorme !
J'ai l'impression
qu'ils se créent dans leurs lettres un petit monde à eux avec leurs
propres références. La politique est quasi absente des lettres.
C'est vrai que la
politique ne les intéressait pas tellement. Aucun des deux n'aurait
voulu adhérer à un parti. Ils auraient certainement été plutôt à
gauche qu'à droite mais ce n'était pas leur problème. Ils avaient
une vision beaucoup plus générale. Au fond, ils pensaient au monde
et ils avaient envie d'aller le découvrir.
Et dans la vie,
quelles étaient leurs sujets de conversation privilégiés ?
D'une certaine manière,
tout leur paraissait sujet à humour. Cela a continué jusqu'au bout,
on a énormément ri ensemble.
Dans quelques passages
ils citent la bible. Quel était le rapport de Nicolas Bouvier à la
religion ?
Ils connaissaient très
bien la bible tous les deux. Nicolas était d'une famille protestante
comme moi, j'avais un grand-père pasteur. Il n'était pas du tout un
homme d'Eglise. Je crois que tout ce qui était conformiste lui
paraissait limité. Il n'était pas croyant au sens où on l'étend,
mais il avait le sentiment d'un au-delà, cela se sent dans ses
poèmes.
Vous avez été au
Japon avec lui lors de son deuxième voyage en 1964 et 1965, quel
était son rapport à ce pays ?
Il
l'a beaucoup aimé, c'est un pays qui l'a beaucoup touché et
lorsqu'il l'a découvert en 1955-1956 c'était un pays encore un peu
ravagé par la guerre et les traces d'Hiroshima. Il le raconte dans
Chronique japonaise,
il était très sensible à cela.
Il a écrit que vous
aviez du mal à vous habituer, que vous étiez un peu déprimée au
début ?
Oui,
mais il ne le dit pas comme cela. Ce qu'il a voulu dire c'est qu'il a
eu peur qu'en arrivant au Japon avec un enfant de deux ans, je sois
comme les autres étrangères qu'il avait rencontrées et que je me
mette à haïr le Japon. Par exemple, des femmes de journalistes
américains qui au bout de dix ans savaient juste dire bonjour et
merci. C'était incroyable. J'ai fait exactement l'inverse.
Dans ses lettres on
voit qu'il fréquente à la fois les communautés d'expatriés qui
peuvent l'aider et qu'il s'intègre à la population locale. Quelle
était sa démarche ?
Tout
à fait, il y avait des deux. Surtout, ce qui l'a frappé à cette
époque c'est qu'après avoir été seul en 1956, il revenait avec
une femme et un enfant, cela a complètement changé l'attitude des
japonais à son égard. C'est étonnant, comme les japonais sont un
petit peu embarrassés, ils passent par l'enfant. Mon fils avait des
cheveux blonds et de yeux bleus. Dans la rue les femmes me
regardaient et après j'ai appris à dire : « C'est bien mon
fils! ». C'est une manière d'entrer en contact avec les gens
et puis on a vécu à la japonaise tout le temps.
Lors de son premier
séjour au Japon il a un questionnement très intéressant : Jusqu'à
quel point on peut s'acculturer sans perdre sa personnalité ?
Il
ne le savait pas vraiment mais nous avons rencontré au Japon un
français qui était là depuis vingt ou trente ans. Lui, il était
devenu trop japonais. Il ne comprenait presque plus notre manière
d'être, c'était surprenant. Il y a une autre manière d'être où
on reste soi-même mais on aime le pays et les gens. On essaye de
créer un lien.
Thierry Vernet, lors
de son retour à Genève, ne se sentait pas du tout à l'aise dans le
matérialisme ambiant. Quelle a été la réaction de Nicolas Bouvier
?
Il
était effrayé quand il est rentré, il est très vite parti à la
montagne et puis je l'ai rencontré trois mois après son retour. Il
était complètement déphasé, il partait à 6h du matin à la gare
pour voir partir les trains en se disant : « Il faut que je
reparte, je ne pourrai pas rester ». Quand je l'ai rencontré
il avait déjà comme projet de voyager en Amérique du Sud avec une
troupe de théâtre. Et puis moi j'étais prête à aller à Bombay
parce que j'en avais marre de la Suisse. On n'est partis ni l'un ni
l'autre parce que l'on s'est rencontrés et on ne s'est plus quittés.
S'il était reparti, il n'y aurait peut être pas eu l'Usage
du monde, allez savoir !
Après la biographie
en 2007 (Payot) et ce livre, doit-on attendre d'autres ouvrages sur
Nicolas Bouvier ?
Je
suis justement aux prises avec une femme qui veut refaire une
nouvelle biographie mais différente. Je lui ai dit : « Mais
écoutez, il y a celle de François Laut, il y a déjà trois thèses
sur Nicolas et une quatrième en cours. Il faut que ça s'arrête
maintenant ! On ne peut pas éternellement presser le citron, faire
des fonds de tiroir. »
Aussi, pas mal
d'écrivains ou de voyageurs ont fait des articles ou des ouvrages
sur les pas de Nicolas Bouvier.
J'ai
reçu beaucoup de gens plus jeunes qui partaient sur les traces de
Nicolas Bouvier et puis qui s'écartaient du chemin. Par exemple,
Gaël Métroz et son film Nomad's
land. Chaque fois que
des jeunes m'ont écrit pour venir me voir, je les ai reçus à la
maison. Je les appelle les enfants de Nicolas. C'est quelque chose
d'une fraîcheur merveilleuse et j'aime, c'est créatif. Quand
Nicolas était encore vivant et que des jeunes gens venaient le
rencontrer pour partir sur les mêmes routes. Il leur disait: « Si
ça ne vous convient pas, rentrez. Ce n'est pas un échec. Ce n'était
pas fait pour vous tout simplement. »
Entretien publié dans le magazine Vie Protestante du mois de février 2011.